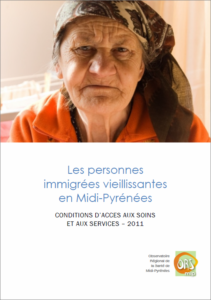août 2013
Le projet s’intéresse à l’expérimentation d’habitats collectifs autogérés pour le potentiel que représente aujourd’hui ce type de formule en termes de développement d’un « habiter différent » respectueux des modèles et idéaux de vie des personnes sans logis.
L’objectif de la démarche a été de partir d’exemples localisés pour tenter d’en tirer des enseignements de portée plus générale. L’enquête a procédé par entretiens croisés, avec les différents acteurs impliqués sur chacun des sites : habitants sans titre, ex SDF, travailleurs sociaux, élus locaux, techniciens des services, intervenants bénévoles… Elle s’est focalisée sur quatre sites en Midi Pyrénées, sur lesquels ont été stabilisés
depuis deux à cinq ans différents groupes de personnes anciennement SDF.
Télécharger le rapport
août 2011
L’objectif de cette recherche-action était de participer à la construction partagée de critères de qualité en partant d’une analyse de la complexité des relations d’acteurs (gestionnaires, professionnels, personnes âgées et leur entourage) et de susciter le débat auprès de l’ensemble des agents impliqués dans l’administration et la mise en œuvre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) au niveau des unités territoriales.
La démarche de recherche a été menée en trois temps : une exploitation de la base de données des bénéficiaires, la passation de questionnaires à 1/10ème de la base (1400 questionnaires) à laquelle ont participé les agents des unités techniques au terme d’un temps de sensibilisation-formation à la démarche, puis l’étude approfondie d’une cinquantaine de situations particulières, pour laquelle les principaux protagonistes ont été approchés (bénéficiaires, leurs proches, leurs intervenants et encadrants des structures et les agents administratifs concernés par leur dossier). La dernière étape, qualitative, a permis d’affiner les résultats des étapes quantitatives et de comprendre, en lien avec les contextes locaux, familiaux et sociaux, l’apport et les limites de l’aide APA. Les résultats détaillés de ce travail ont été consignés dans le rapport final.
Télécharger le rapport
Télécharger la synthèse
juillet 2011
Cette étude multisites a été réalisée dans six départements métropolitains aux caractéristiques contrastées, et a mobilisé un collectif interrégional de recherche. Elle s’est centrée sur deux types de situations : de personnes ayant récemment intégré une structure d’hébergement spécifique, et de personnes considérées au moment de l’enquête par les acteurs en charge de leur accompagnement, comme se situant « en limite » de maintien à domicile. L’analyse a d’abord porté sur la nature des échanges, négociations et arbitrages entre la personne âgée, les membres de son entourage familial et les acteurs professionnels impliqués dans la prise de décision et la qualification des situations. Une attention particulière a en outre été portée sur le rapport au risque des acteurs en présence, sur les critères et normes qui incitent à orienter ou à s’orienter vers une institution, sur les profils de personnes les plus fragiles.
Télécharger le rapport
Télécharger la synthèse
juillet 2011
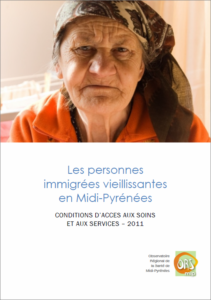 La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a souhaité faire un état des lieux en 2011 sur la situation de migrants vieillissants et sur leurs conditions d’accès aux soins et aux services en Midi-Pyrénées afin de guider l’élaboration d’une politique qui favorise la prise en compte de ce public par les acteurs de droit commun et qui participe à la réduction des inégalités sociales de santé. Quatre axes de travail ont structuré cette recherche d’éléments diagnostics : L’animation d’un groupe technique, chargé de valider la démarche et les résultats, réunissant chercheurs, acteurs institutionnels et associations ; Une synthèse bibliographique afin de dégager les freins à l’accès aux droits et aux services des migrants âgés ; La mobilisation et l’analyse des données et indicateurs accessibles afin de présenter les principaux repères chiffrés qui peuvent servir de données de cadrage ; Des entretiens semi-directifs, sur deux pôles ruraux : Lavelanet, Moissac et un pôle urbain : Toulouse, auprès des professionnels et associations intervenant dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des populations en difficultés d’accès aux soins et aux services (CCAS, SSIAD, Service social de l’hôpital, EHPAD,).
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a souhaité faire un état des lieux en 2011 sur la situation de migrants vieillissants et sur leurs conditions d’accès aux soins et aux services en Midi-Pyrénées afin de guider l’élaboration d’une politique qui favorise la prise en compte de ce public par les acteurs de droit commun et qui participe à la réduction des inégalités sociales de santé. Quatre axes de travail ont structuré cette recherche d’éléments diagnostics : L’animation d’un groupe technique, chargé de valider la démarche et les résultats, réunissant chercheurs, acteurs institutionnels et associations ; Une synthèse bibliographique afin de dégager les freins à l’accès aux droits et aux services des migrants âgés ; La mobilisation et l’analyse des données et indicateurs accessibles afin de présenter les principaux repères chiffrés qui peuvent servir de données de cadrage ; Des entretiens semi-directifs, sur deux pôles ruraux : Lavelanet, Moissac et un pôle urbain : Toulouse, auprès des professionnels et associations intervenant dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des populations en difficultés d’accès aux soins et aux services (CCAS, SSIAD, Service social de l’hôpital, EHPAD,).
Télécharger le rapport
août 2010
L’objectif de l’étude est à plusieurs niveaux :
– prendre la mesure, même sommaire, des avancées réalisées par les structures dans le sens de la loi 2002 en Midi‐Pyrénées
– faire la part des freins et des obstacles que rencontre la mise en œuvre de la Loi
– valoriser les expériences innovantes portées par les structures, les projets engagés.
Télécharger l’étude
juillet 2009
Le point de vue des personnes les plus précarisées est rarement pris en compte dans la définition des politiques du « sans abrisme ». Le regard que les personnes portent sur leur situation propre et sur leur parcours, leur expérience propre de « la rue », des dispositifs en présence, ont le plus souvent peu de place dans les échanges qui participent à la définition des besoins, ou sont relayés dans des conditions incertaines, dans un secteur de l’action sociale où les acteurs, professionnels ou bénévoles, se vivent eux-mêmes en situation de précarité. Le projet est donc à plusieurs ressorts : restituer la parole des usagers des dispositifs, comme des « non usagers », personnes en marge de l’offre d’hébergement et d’accompagnement social afin de rendre compte de la grande diversité des parcours et expériences individuelles et collectives ; mieux saisir les ressources que mobilisent les personnes entre l’offre formalisée et ressources informelles afin d’étudier leurs systèmes de référence (des modèles, valeurs, aspirations, projets de vie) ; analyser dans quelles relations se trouvent les personnes sans logis entre elles et avec les différents intervenants en présence (travailleurs sociaux, éducateurs…) ; tester le potentiel de « médiation » autour des personnes sans logis. La méthode utilisée est celle des entretiens (110 à 120) réalisés dans 13 villes des huit départements de la région Midi-Pyrénées. Ce rapport présente les résultats autour de trois grands chapitres : les formes de médiation et les positions des intervenants qui ont été sollicités ; les profils de grands précaires ; la parole des sans logis sur les dispositifs d’hébergement et d’accompagnement. Un second rapport regroupe les enseignements et la synthèse de cette étude. (extrait de l’introduction)
Télécharger le rapport d’étude
Télécharger la synthèse
Télécharger les annexes