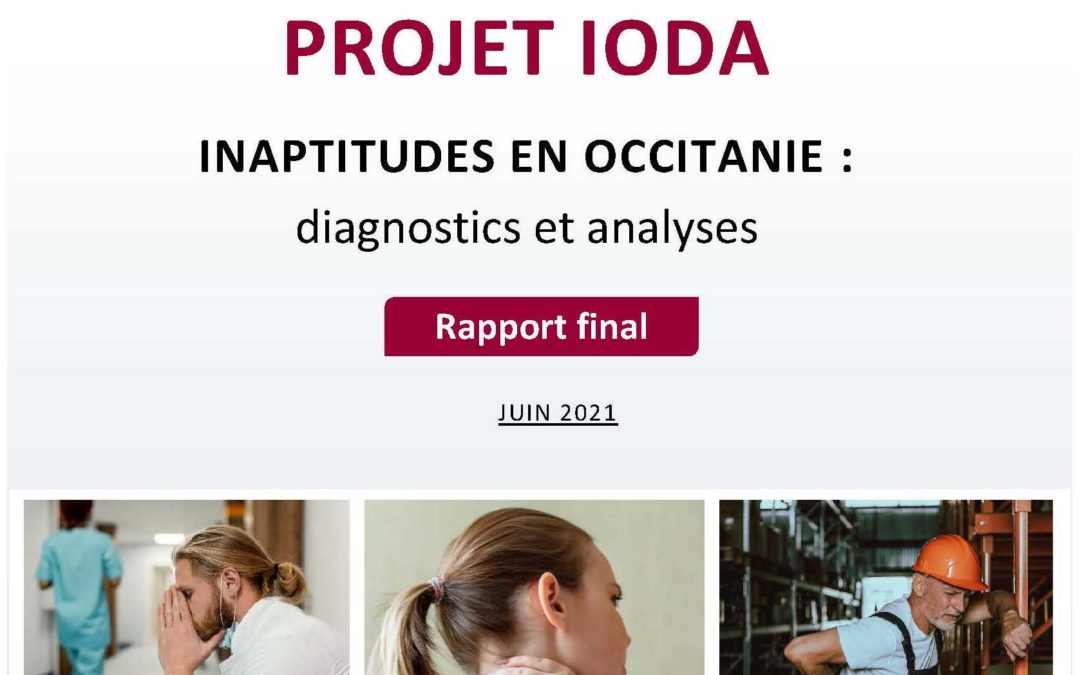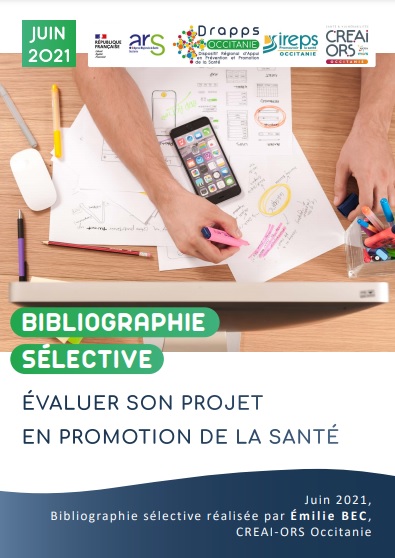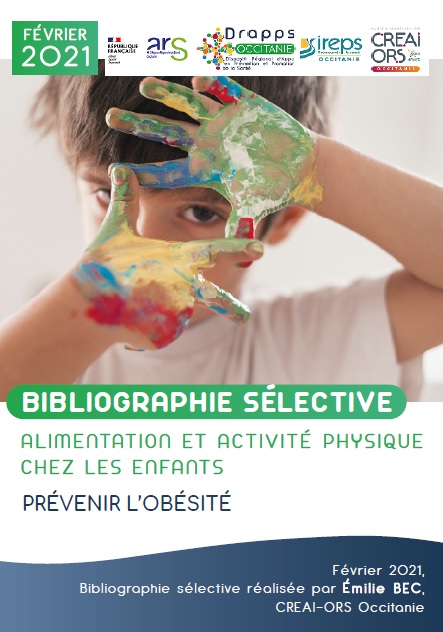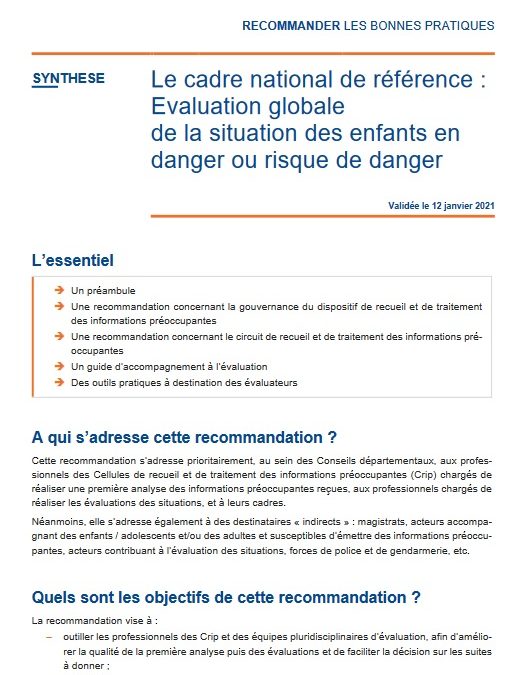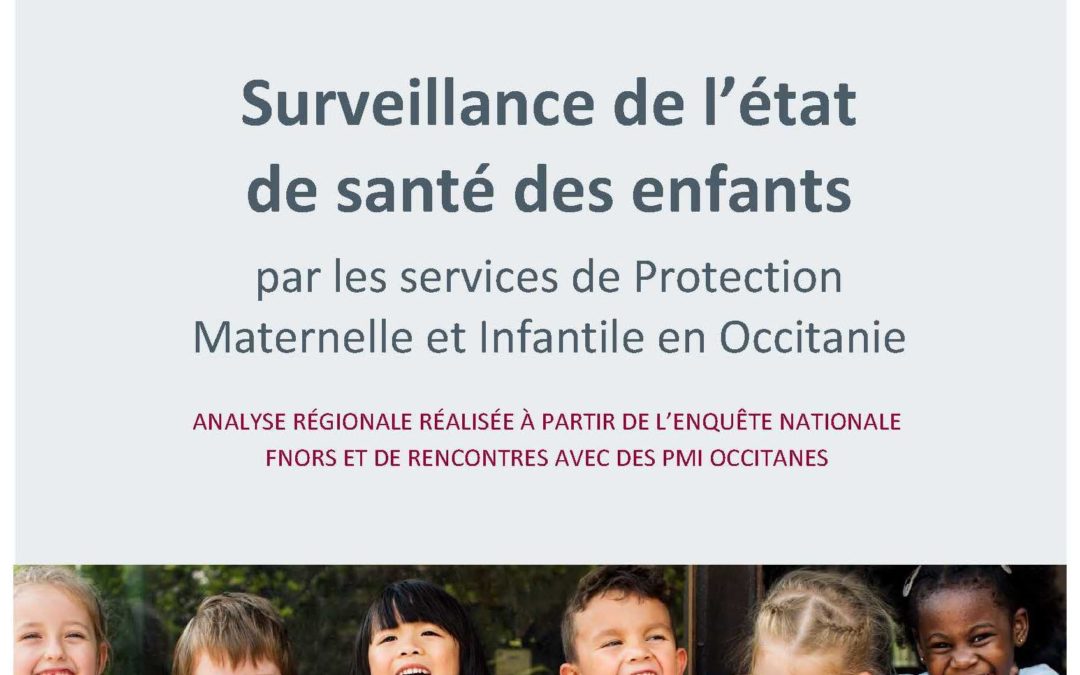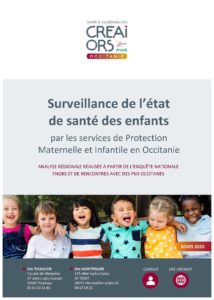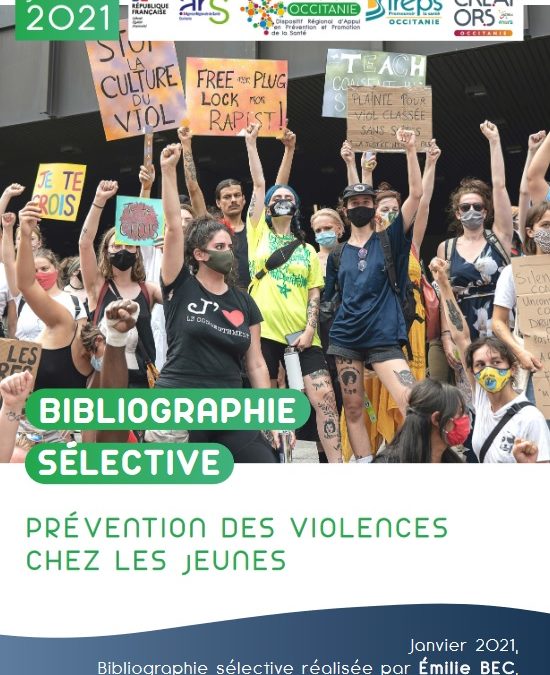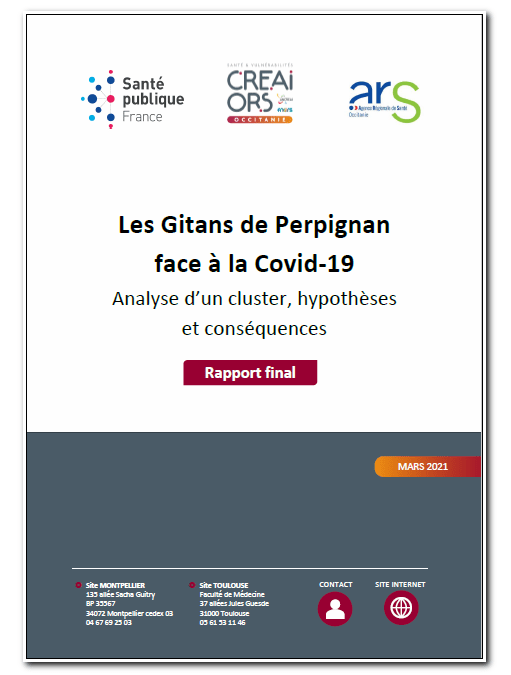
Les Gitans de Perpignan face à la Covid 19. Analyse d’un cluster, hypothèses et conséquences
En 2020, à la veille du premier confinement, la ville de Perpignan et particulièrement les quartiers habités par la communauté gitane, ont été identifiés comme « clusters ». Pour comprendre la rapide propagation du virus et la virulence de l’épidémie (47 cas au 20 mars soit 3 jours après l’annonce du confinement, 15 patients en réanimation et 5 décès), une étude qualitative menée par le CREAI-ORS Occitanie et financée par l’ARS Occitanie et Santé publique France, décrit de l’intérieur la réorganisation de l’action publique et associative ; grâce aux discours d’une quinzaine d’intervenants impliqués en « première ligne ». Elle rapporte et analyse également le vécu des publics résidents durant cette période particulière en allant à la rencontre d’une trentaine d’habitants.
L’étude montre que la rapide propagation du virus et sa virulence sont liées à des conditions de vie sociale et économique défavorables, véritables déterminants de santé, qui ont impacté la santé physique et psychique de cette communauté déjà fragilisée.
L’analyse du vécu de la crise sanitaire du point de vue des habitants met en avant trois types d’expériences – confinement-protection, confinement-adaptation et confinement-prison – qui se retrouvent en population générale et qui ne sont pas spécifiques à la culture gitane. Télécharger le rapport
> Pour aller plus loin : Conséquences du Covid-19 chez les Gitans de Perpignan. L’impact des déterminants sociaux de santé avant la culture. Yeghicheyan J, Srocynski M. Vidéo