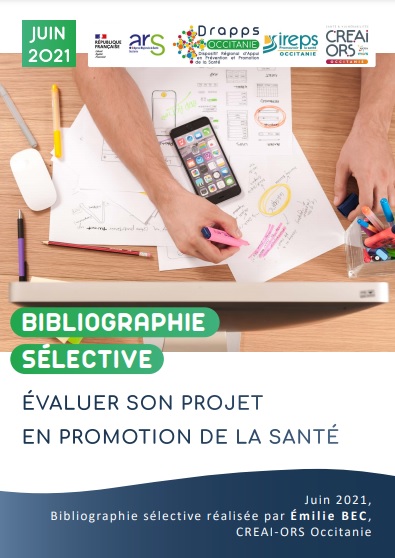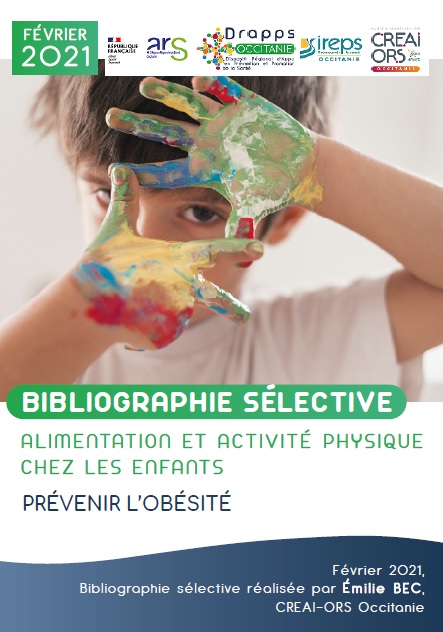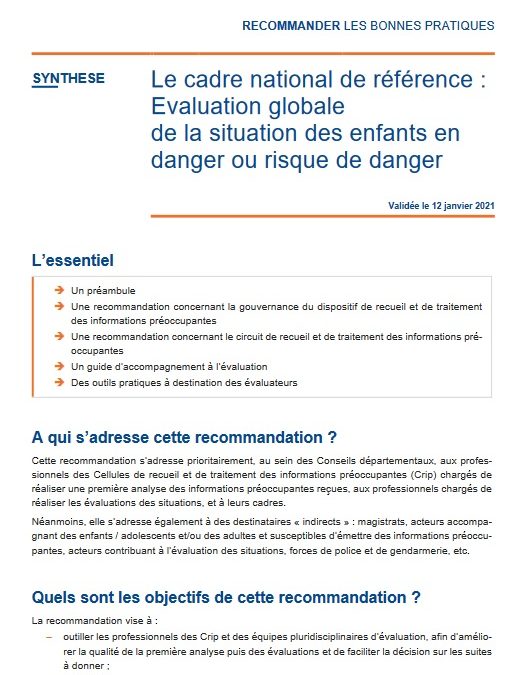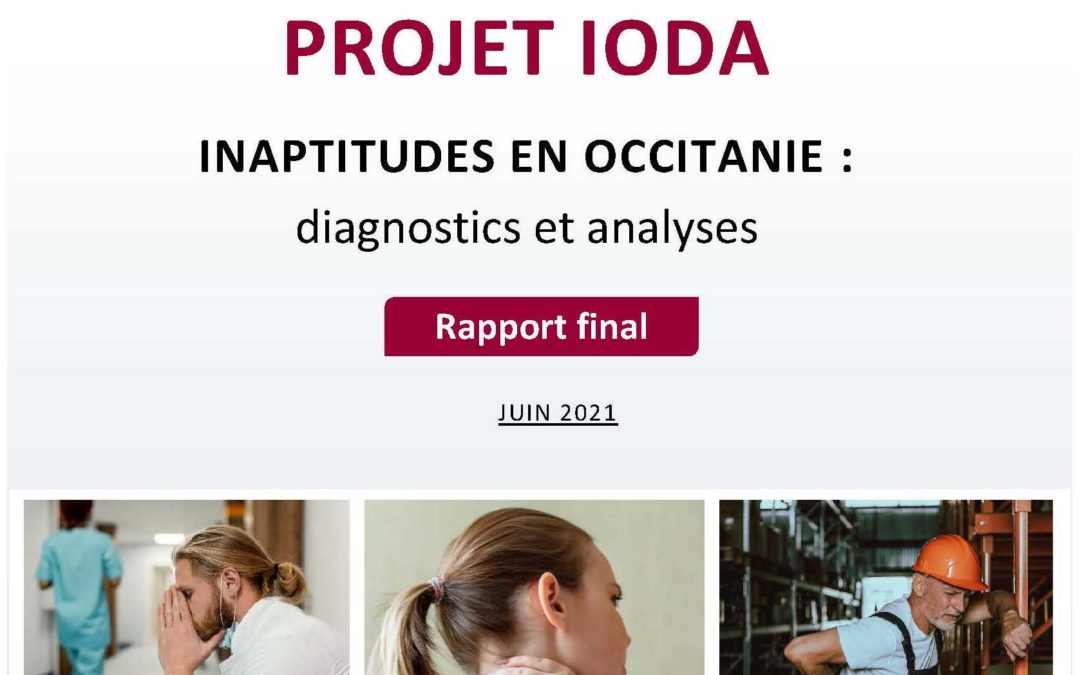
juin 2021
 Le projet IODA – Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic et Analyses – est l’expérimentation d’un système de surveillance épidémiologique des inaptitudes médicales au travail à l’échelle d’une région afin d’éclairer les stratégies de prévention locales et régionales.
Le projet IODA – Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic et Analyses – est l’expérimentation d’un système de surveillance épidémiologique des inaptitudes médicales au travail à l’échelle d’une région afin d’éclairer les stratégies de prévention locales et régionales.
Les médecins de 23 services occitans de santé au travail interentreprises ont enregistré dans leur logiciel métier le ou les diagnostics en cause pour chaque déclaration d’inaptitude. Au bout d’un an, dans l’ensemble de ces services, les données caractéristiques de tous les salariés suivis et les diagnostics portés pour ceux déclarés inaptes ont été extraits et transmis au CREAI-ORS pour constitution d’une base régionale et analyse des données.
Les taux d’incidence des déclarations d’inaptitude ont ainsi été estimés pour différents groupes de travailleurs et différents groupes de pathologies. De plus, certains facteurs de risque ont été identifiés vis à vis de la déclaration d’inaptitude « toutes pathologies », « pathologie de l’appareil locomoteur » et « troubles mentaux ou du comportement ». Au sein du groupe des salariés déclarés inaptes, certains facteurs de risque, différenciés en fonction de la pathologie en cause, ont été mis en évidence.
La pérennisation de IODA permettrait le suivi temporel du taux d’incidence des déclarations d’inaptitude, indicateur majeur de santé au travail, et contribuerait également à l’évaluation des actions de prévention mises en place.
Télécharger le rapport
Télécharger la synthèse
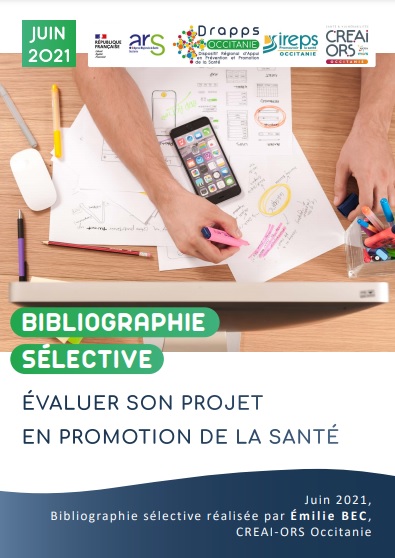
juin 2021
L’évaluation est définie comme une démarche, un processus, un moyen permettant de mesurer, de juger de connaître, d’améliorer et de décider de la valeur, de l’efficacité ou de la qualité d’une action. Elle est désormais devenue une pratique incontournable en éducation et promotion de la santé. Pourtant, elle peut susciter encore des réticences car elle peut apparaître comme complexe et questionne la qualité de l’intervention. Exercice continu qui se réfléchit en amont de l’intervention, externe ou interne, le travail évaluatif doit se soumettre à un questionnement préalable : évaluer, pourquoi ? quoi ? avec qui ? pour qui ? pour quoi faire ? comment ? L’explicitation des objectifs, la définition du champ de l’évaluation, la clarification du questionnement et la définition des modalités de travail sont des épreuves obligatoires. Il s’agit de rendre explicite ce qui ne l’est pas. Cette réflexion initiale doit permettre de s’entendre sur l’utilisation de cette évaluation, les questions à poser et les critères de jugement. En effet, ce choix n’est pas neutre et relève d’un acte collectif qui engage l’ensemble de la démarche. En plus de montrer l’efficacité des interventions, l’évaluation vise aussi à améliorer les pratiques, appuyer des revendications, faire reconnaitre un secteur d’intervention, redonner du sens et une légitimité aux pratiques, assurer la continuité des programmes, favoriser une meilleure utilisation des fonds publics, améliorer le pilotage et la visibilité des politiques de promotion de la santé. Cette bibliographie propose une sélection de références sur la thématique de l’évaluation. Elle commence par présenter des références méthodologiques sur la construction de projet en promotion de la santé et plus précisément sur l’évaluation. Elle propose ensuite des données sur l’évaluation d’impact en santé (EIS) avant de valoriser des exemples concrets d’évaluation d’actions et de programmes mis en place sur le terrain.
En savoir plus

mai 2021
Cette bibliographie commence par présenter les données générales sur la pleine conscience avant de fournir des ressources sur ses bénéfices sur la santé. Elle valorise ensuite des actions mises en place sur le terrain.
En savoir plus

avril 2021
Cette bibliographie propose une sélection de références sur la vie affective et sexuelle des jeunes. Elle commence par présenter les données générales sur la santé sexuelle. Elle fait ensuite un focus sur le développement psychosexuel des enfants. Elle aborde également la vie affective et sexuelle des jeunes et leurs comportements et leurs pratiques. Pour finir, elle présente des références de programmes d’éducation à la sexualité, des actions mis en place sur le terrain et des outils visant à favoriser une bonne santé sexuelle des jeunes. Cette bibliographie ne traite pas des violences sexuelles. Une bibliographie spécifique sur la prévention des violences chez les jeunes, réalisée en début d’année 2021, comporte une partie dédiée aux violences sexistes et à caractère sexuel.
En savoir plus
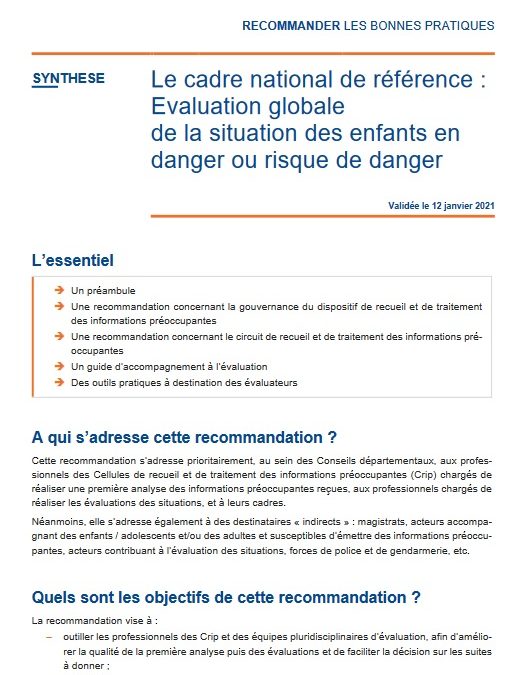
janvier 2021
La Haute autorité de santé vient de publier le premier cadre national de référence pour l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger.
Ce guide se présente sous forme de 3 livrets. Le premier livret aborde la gouvernance globale du dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes à l’échelle du département. Le second traite du circuit de recueil et de traitement des informations préoccupantes : étapes, acteurs concernés, contenu, attendu, processus et outils. Le troisième livret propose des outils d’évaluation. Chacun d’entre eux se compose du rappel du cadre juridique, de recommandations et d’outils pratiques.
Pour accéder à l’intégralité du guide
Formation ANCREAI
L’ANCREAI propose une offre de formation en prévention et protection de l’enfance.
Pour en savoir plus.
Eléments de contexte : de la réforme de 2007 à celle de 2016
La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance est présentée comme une avancée significative pour la protection de l’enfance en France. Elle est le fruit d’une large concertation entre l’État et les professionnels du secteur. Selon le rapport de Philippe BAS, de mai 2006, l’un des buts de la loi est de multiplier les points de contacts entre enfants, famille et professionnels pour anticiper les difficultés et soutenir les familles avant que leurs situations ne se détériorent. C’est pourquoi, l’un des apports majeurs de la loi de 2007 est de créer un dispositif mieux organisé de détection des enfants en situation de danger, autour des cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes (CRIP). Il s’agit de clarifier le cadre et les procédures de traitement des informations concernant les mineurs en danger et de favoriser une meilleure articulation entre les acteurs qui mettent en œuvre la protection de l’enfance.
Afin de faciliter l’application de la loi, 5 guides pratiques sont publiés par le ministère dès 2007, dont le guide de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation. Ce guide vise à donner un cadre national de référence aux professionnels chargés de l’évaluation des situations individuelles des mineurs et à préconiser des recommandations pour la rédaction des rapports d’évaluation. Cette nouvelle organisation permet d’améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de l’être.
En 2014, le rapport MEUNIER – DINI fait état de fortes disparités territoriales quant à la mise en œuvre de la protection de l’enfance, en particulier concernant les modes de recueil et d’évaluation des informations préoccupantes. C’est pourquoi, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant prévoit finalement que le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) promeuve la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Pour autant, fort de l’expérience de la loi de 2007, appliquée qu’en partie par les Conseil départementaux (notamment sur la question des Projets Pour l’Enfant (PPE) ou des Observatoires Départementaux de la Protection de l’Enfance(ODPE)), la loi de 2016 prévoit qu’un cadre national de référence viennent soutenir sa mise en œuvre. C’est donc plus d’une vingtaine de textes réglementaires d’application qui sont publiés en 2016 et 2017. Ainsi, le décret d’application du 28 octobre 2016 relatif à l’évaluation de la situation des mineurs vient préciser les conditions de mise en œuvre de cette évaluation, afin de disposer de référence partagées, d’harmoniser et de fiabiliser les résultats de l’évaluation des situations. Pour autant, le corpus législatif et règlementaire relatif à l’évaluation du danger soulève encore des difficultés d’ordre opérationnel. Par exemple, si des référentiels d’évaluation du danger sont développés en France, ils datent d’avant la loi de 2016, de ses décrets d’application et de la démarche de consensus qui en découle, et ne prennent donc pas en compte leurs apports. D’autre part, les référentiels d’évaluation n’abordent que peu « le circuit » de l’IP, du recueil à la transmission éventuelle au parquet. Enfin, la question de la gouvernance globale du dispositif n’est pas du tout évoquée dans les référentiels préexistants.
La recommandation parue le 20 janvier 2020 s’inscrit ainsi dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance et du plan ministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, dans le prolongement des conclusions formulées à l’issue de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant, qui préconisait notamment l’établissement d’un CADRE DE REFERENCE NATIONAL CONCERNANT L’EVALUATION DES SITUATIONS.
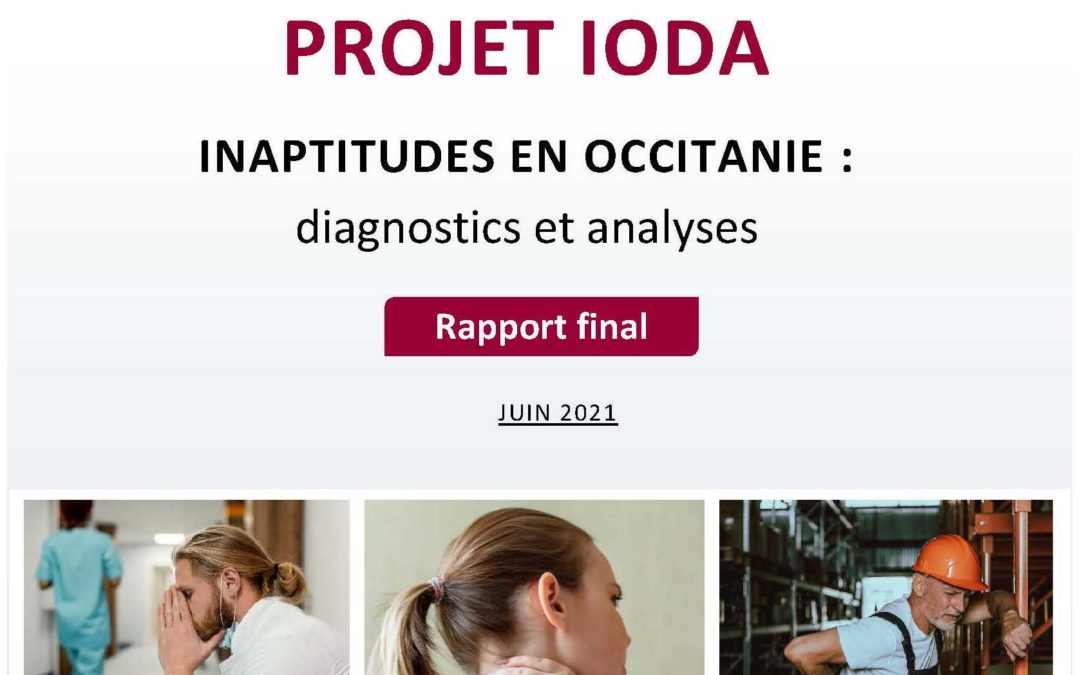
 Le projet IODA – Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic et Analyses – est l’expérimentation d’un système de surveillance épidémiologique des inaptitudes médicales au travail à l’échelle d’une région afin d’éclairer les stratégies de prévention locales et régionales.
Le projet IODA – Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic et Analyses – est l’expérimentation d’un système de surveillance épidémiologique des inaptitudes médicales au travail à l’échelle d’une région afin d’éclairer les stratégies de prévention locales et régionales.